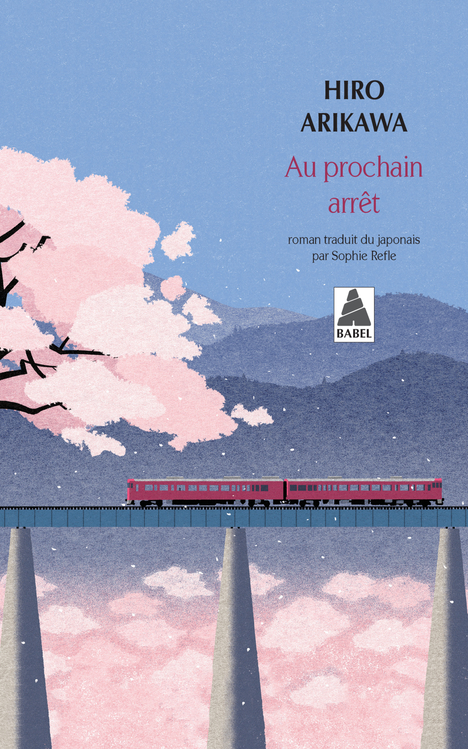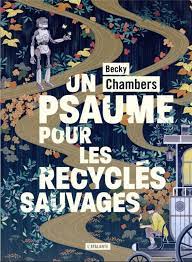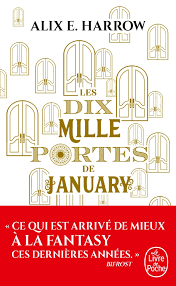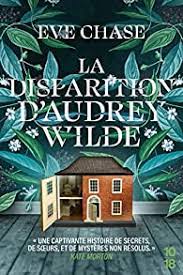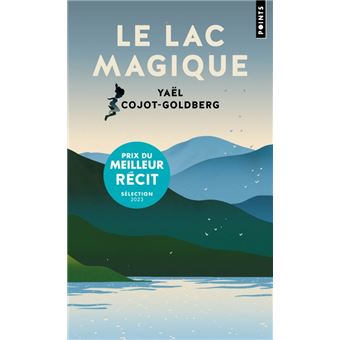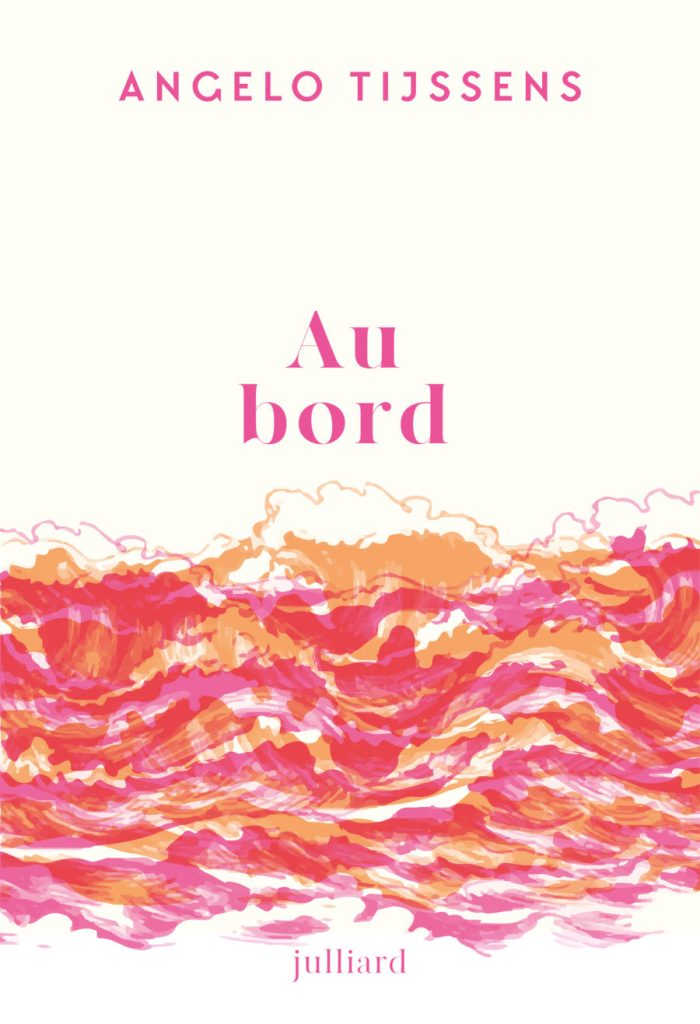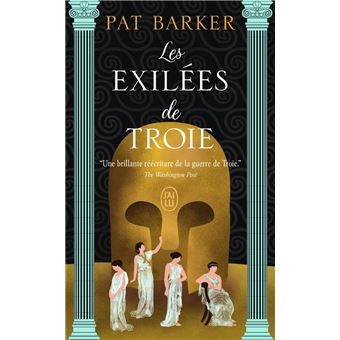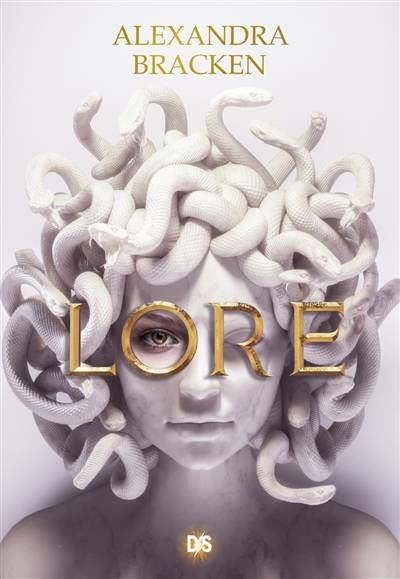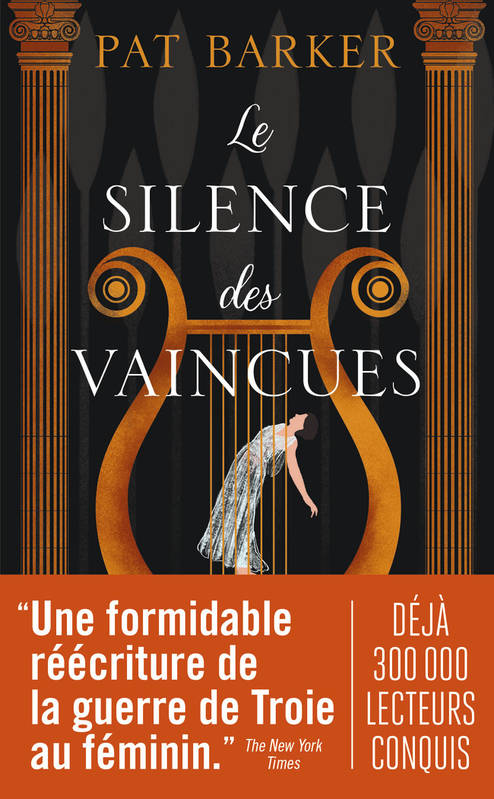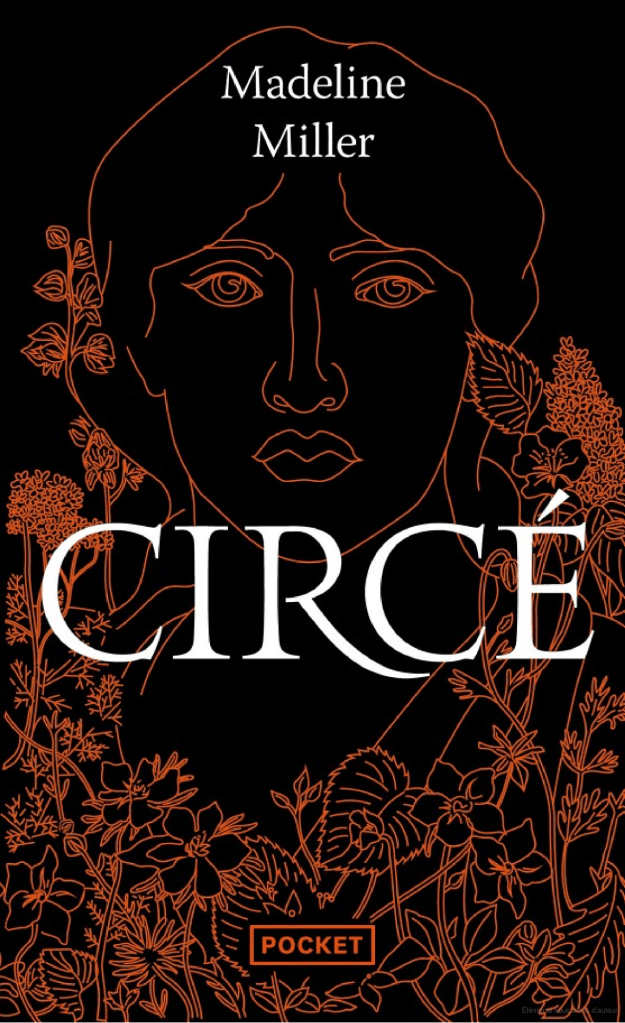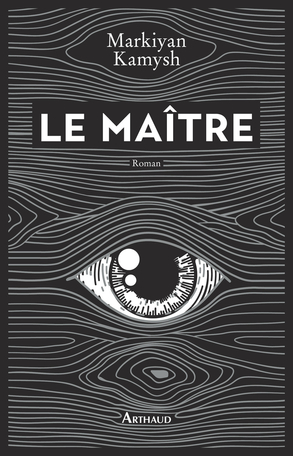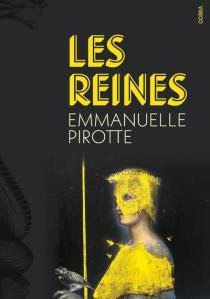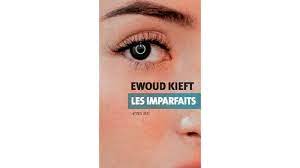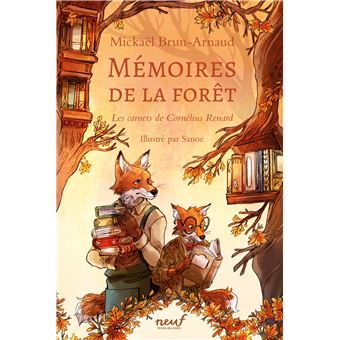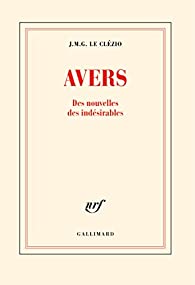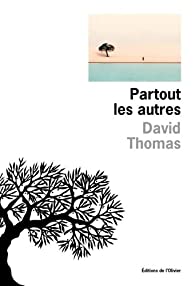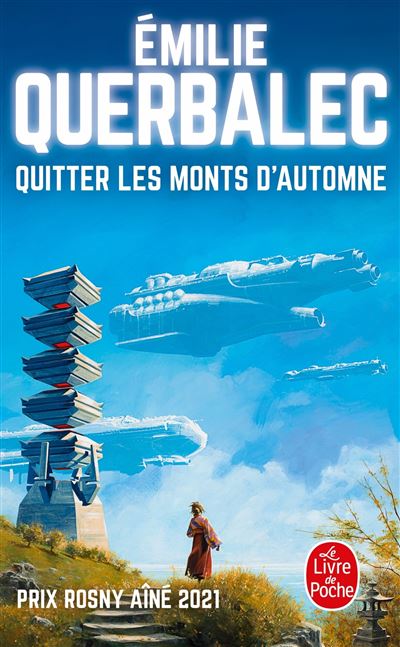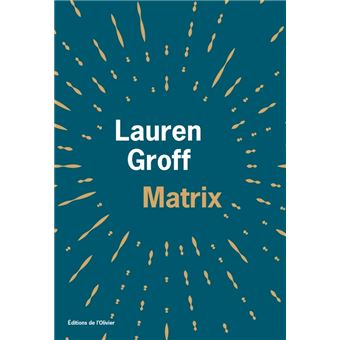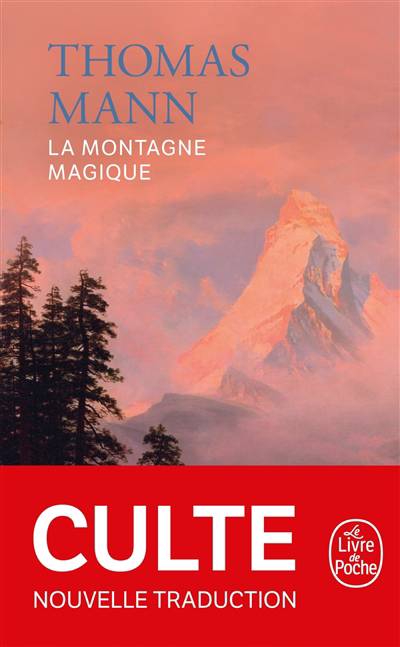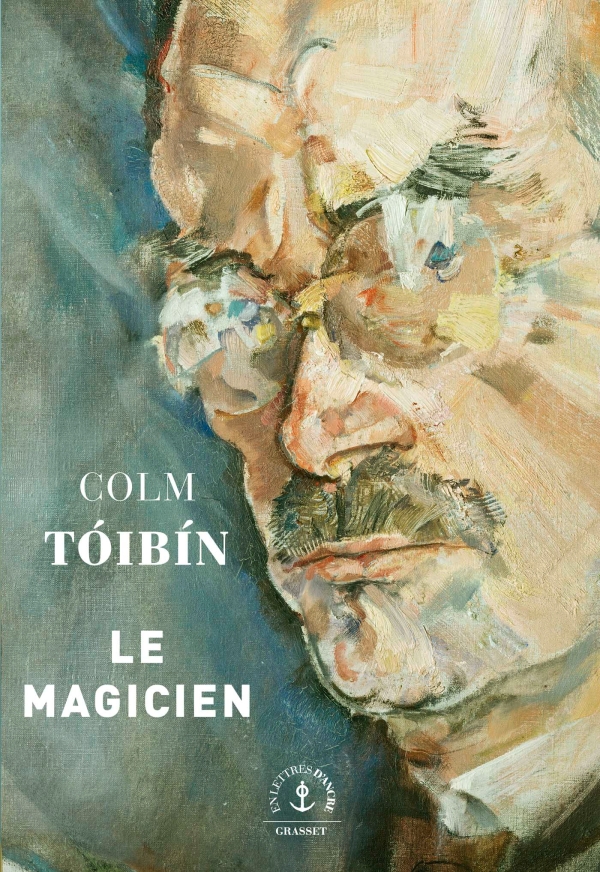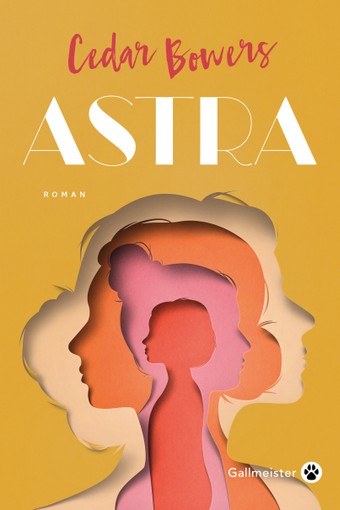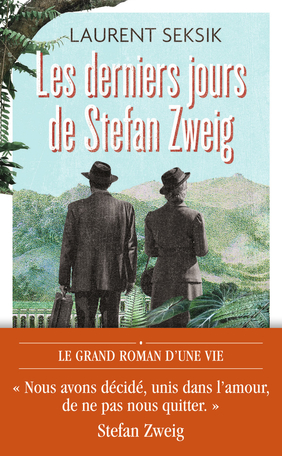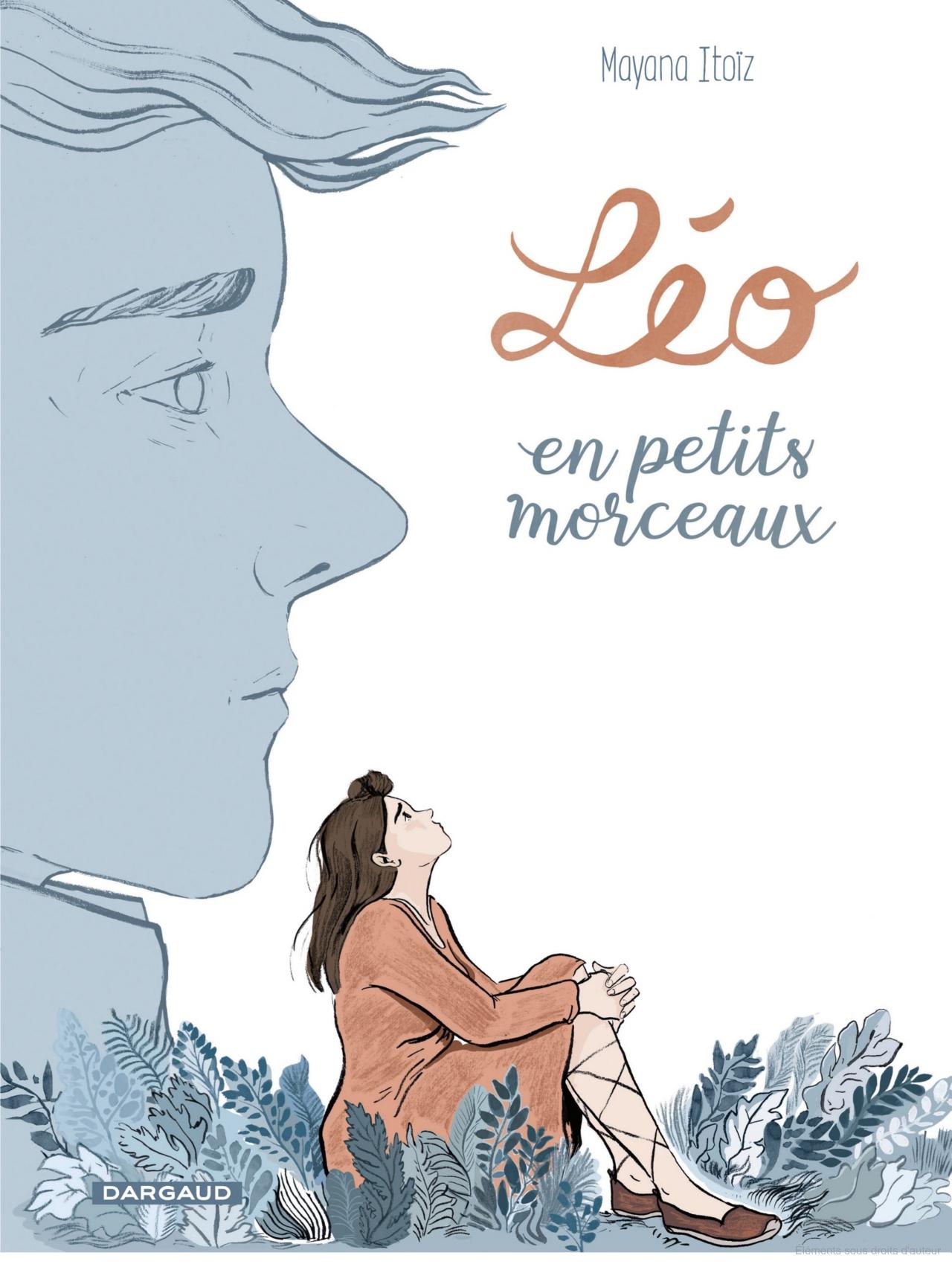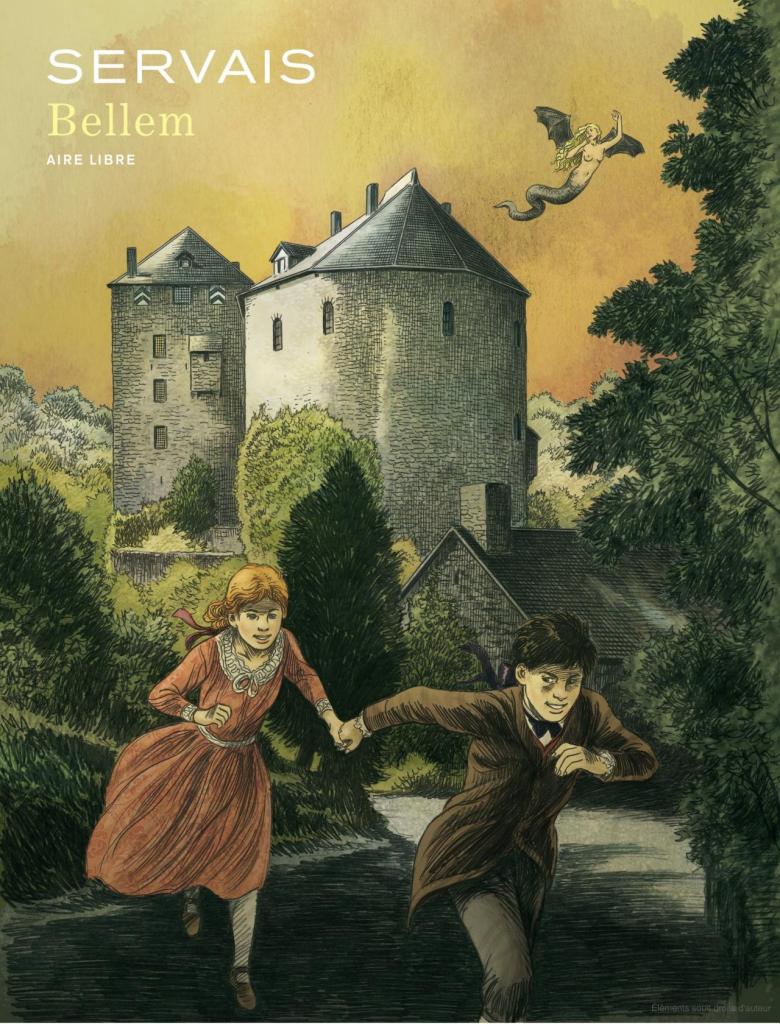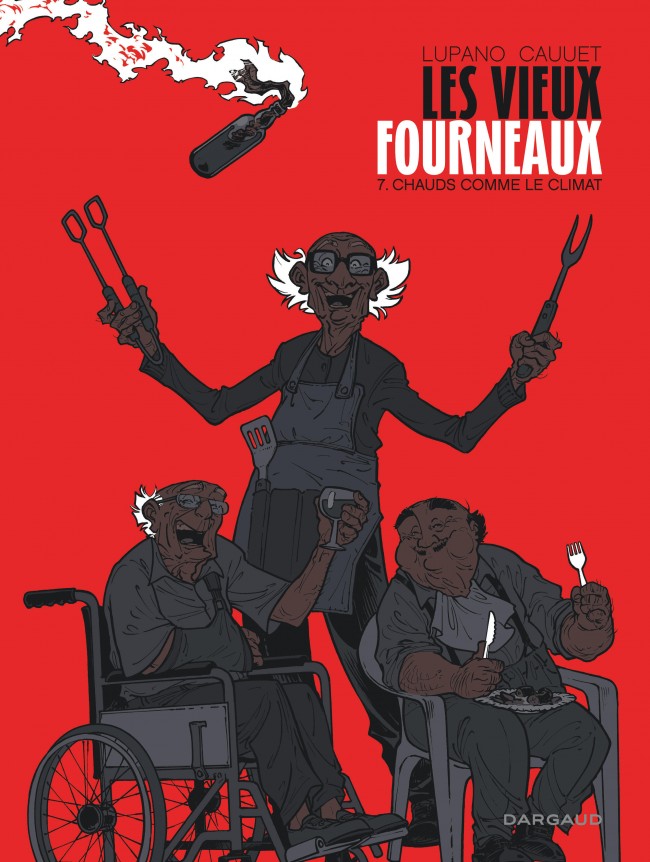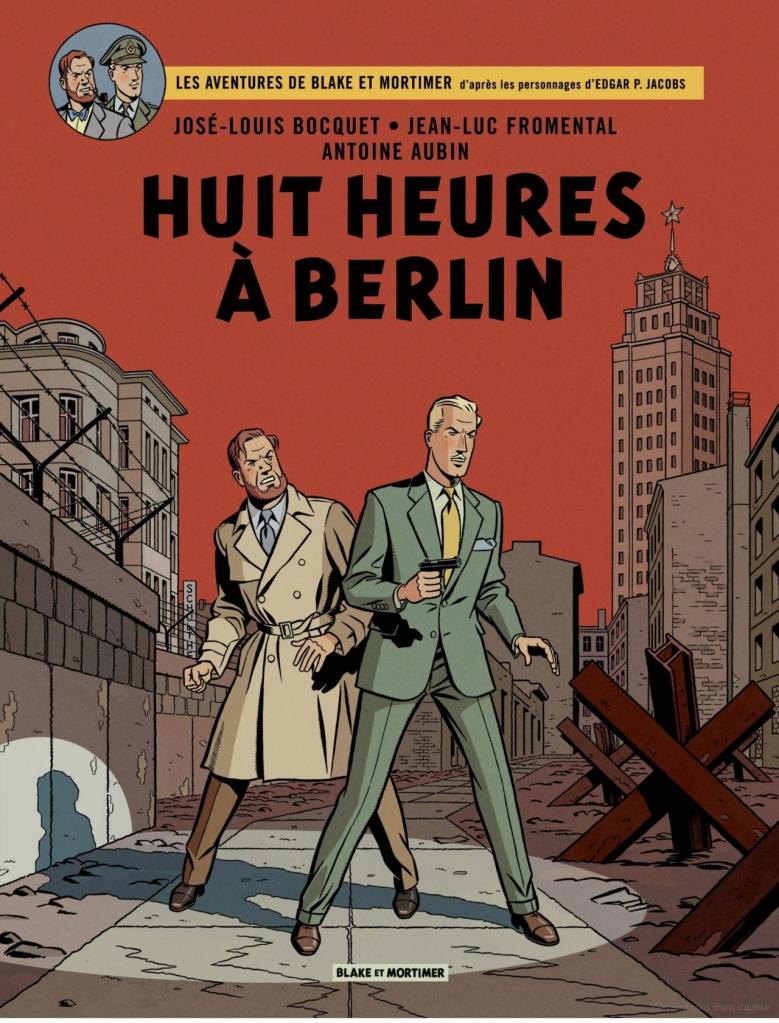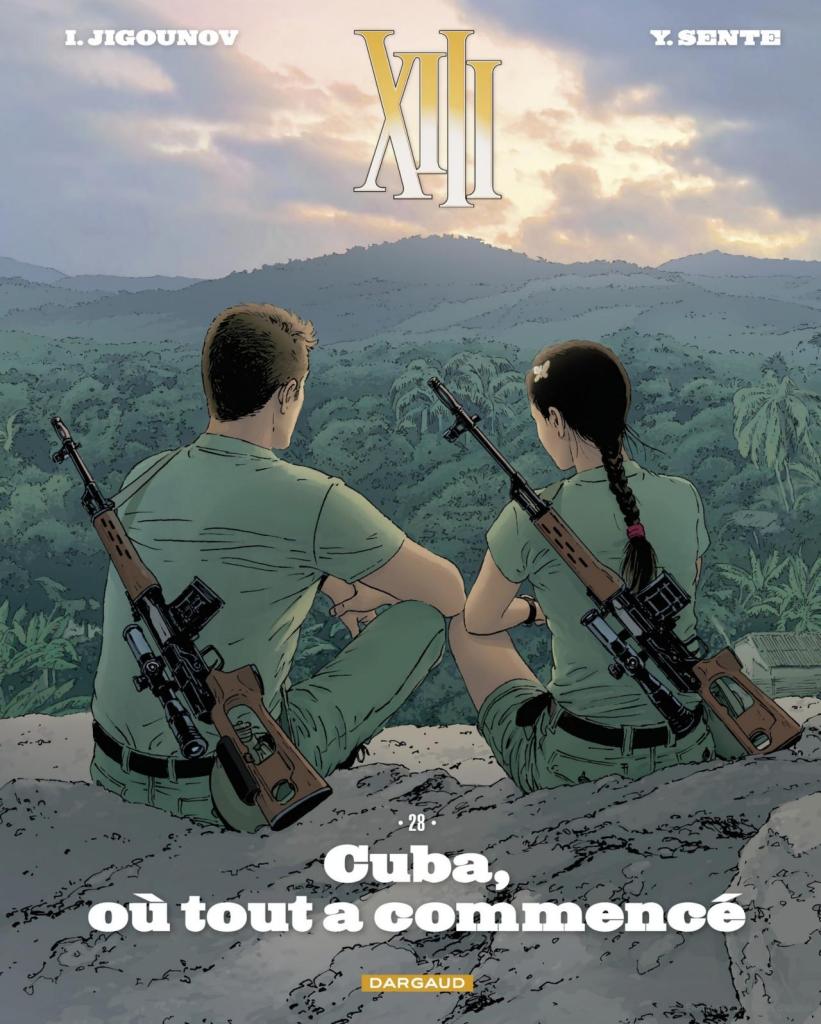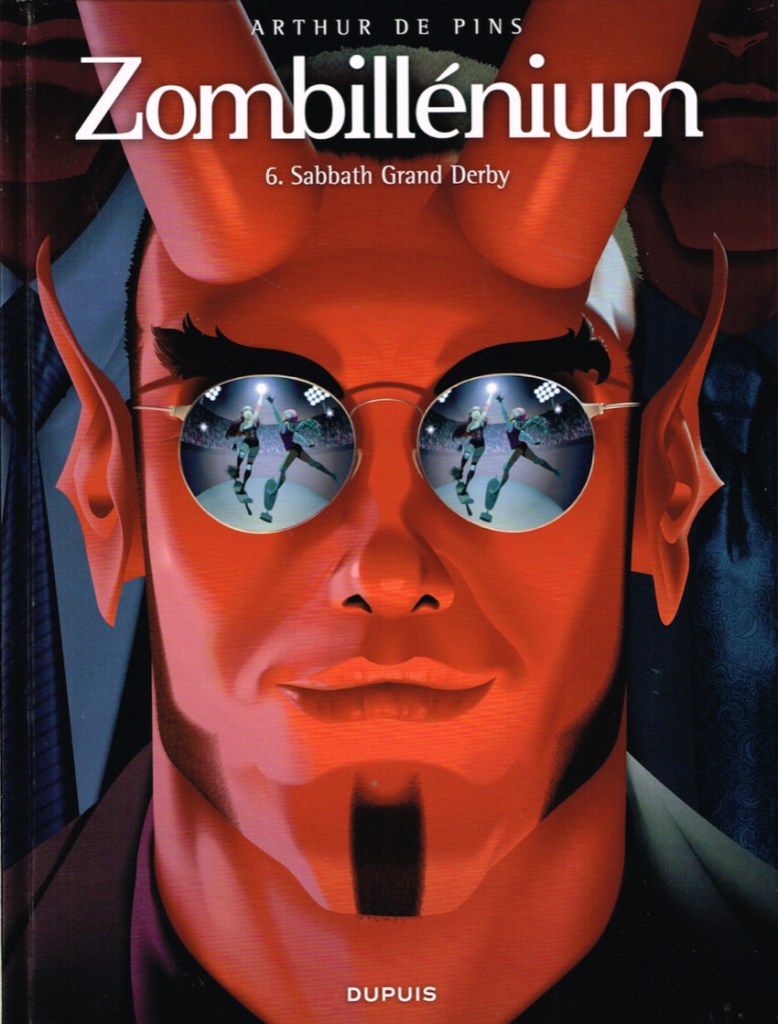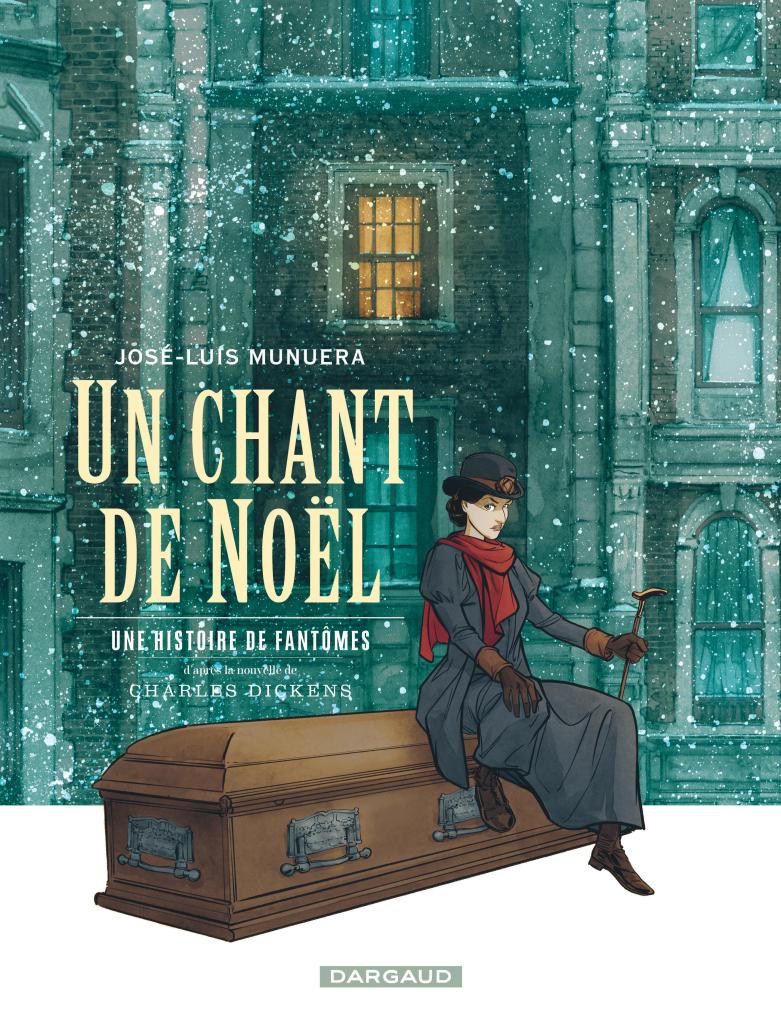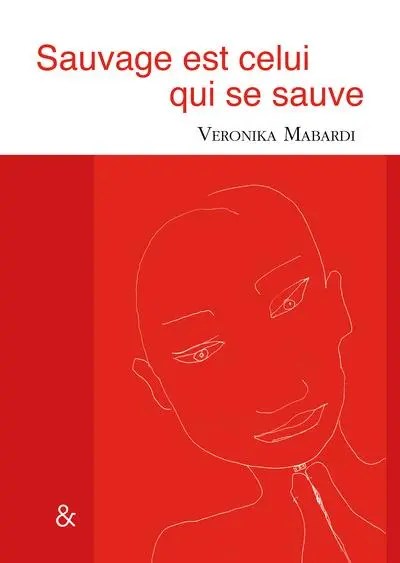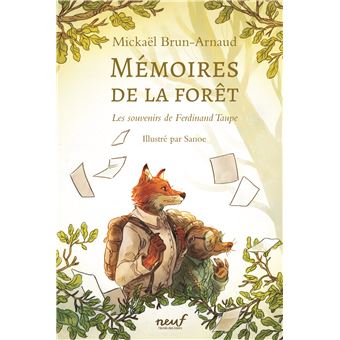Voici la dernière lecture commune de notre Club de lecture et autant dire que l’enthousiasme était au-rendez-vous pour ce livre iconoclaste.
Sous la forme d’un roman, l’auteur nous propose une réflexion sur le travail et le temps qu’on y consacre tout au long de notre vie. Son personnage principal, Emilien Long, est un prix Nobel d’économie français qui doit normalement sortir un nouveau livre mais, comme il le dit à son éditrice, il n’a pas très envie de faire un nième livre d’économie, il voudrait autre chose. Et justement, le confinement passe par là. Voilà Emilien, cloîtré dans son cabanon près de Marseille avec son ordi, son hamac et du temps devant lui. Justement, en général, du temps, il n’en a pas beaucoup entre ses conférences, ses cours, ses enfants et la maison à tenir. Cette pause forcée lui rappelle un livre paru à la fin du 19° siècle, Le droit à la paresse de Paul Lafargue, Emilien décide donc d’écrire en septembre 2020 une nouvelle version de ce livre » Le droit à la paresse au 21° siècle ». Le livre devient immédiatement un succès. Emilien Long, qui n’avait pas pensé à ça, est convaincu par ses amis de créer un nouveau parti politique pour se présenter aux élections présidentielles de 2022. Le but de ce parti ? « Sortir d’un productivisme morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre ». L’idée de base est que grâce à une journée de 3 heures de travail, le reste du temps pourrait être consacré au bien-être collectif. « Une France apaisée, salubre, sereine, produisant moins de biens inutiles, plus de sens et plus de bonheur ».
p 47 « Il va falloir (…) leur expliquer la différence entre paresse, la noble paresse, la riche paresse, et flemme., la molle flemme, la médiocre flemme. Leur dire que leur avenir ce n’est pas fumer des joints toute la journée pour célébrer Paul Lafargue, mais simplement d’inventer leurs choix individuels et collectifs, ce qu’il peuvent faire de leur temps libre – la paresse pour en tirer quelque chose de réel et pas pour le fuir, ce réel. La paresse dans un forme d’action. Ouvrir un espace, des espaces, et s’en servir pour remplir sa vie. La paresse comme une idée de la liberté, de la non-soumission aux contraintes du travail productiviste. »
Le début du roman est entrecoupé de quelques chapitres plus théoriques comme si nous lisions le traité d’Emilien Long et puis nous sommes réellement embarqués dans la création d’un nouveau parti politique et enfin dans la campagne à la présidentielle du héros. On se prend au jeu et la tension monte au fil du livre pour savoir si cet improbable candidat à la présidentielle française va gagner ou non le scrutin. Mais ça, à vous de le découvrir en lisant le livre !
Notre club de lecture est intergénérationnel, la benjamine a 23 ans et la plus âgée, aux alentours de 80 ans et pourtant ce livre a plu à presque tout le monde et surtout, nous avons eu les témoignages des deux plus jeunes du groupe qui nous ont dit qu’elles mettaient déjà ça en pratique et que leurs amis le faisaient également. Bien sûr, les indépendants du groupe ont objecté que ce serait difficile pour eux de renoncer à travailler pour servir leurs clients, si on ne répond pas, ils vont aller voir ailleurs. Oui, en effet, mais si tout le monde fonctionne ainsi, il y aura plus de travail pour tout le monde.
Pas facile d’entrer dans le postulat du livre mais rafraîchissant d’y penser en tout cas,
Voici les quelques commentaires des participants :
« C’est un roman qui donne de l’espoir, permet de voir vers quoi on veut aller », Fanny, 23 ans
« Amusant, ironie judicieuse » Nicole, 80 ans
« C’est un roman à thème et pourtant j’ai été pris par l’histoire ce qui n’est pas toujours le cas quand je lis ce genre de roman ». Philippe
« Ce livre m’a fait penser à une autre lecture : L’âge de la résilience de Jeremy Rifkin aux Liens qui libèrent ». Stéphane
« Un livre politique et pourtant on ne se dispute pas sur le sujet, incroyable ! Mais pour mettre cela en pratique, il va falloir changer les mentalités en commençant par soi-même ». Stéphane.
« livre atypique, je me suis laissée embarquer par l’idée, on a l’impression de marcher vers un avenir. » Audrey.
Voilà une lecture qui a plu et que nous vous conseillons vivement. Plus nombreux nous serons à l’avoir lu, plus vite on arrivera à une société apaisée ? Espérons.
Et si ça vous intéresse, l’auteur, qui utilise un pseudonyme, a déjà publié plusieurs livres.
Et qu’advienne le chaos en 2010, La grande panne en 2016 et 2020, et la suite de Paresse pour tous, intitulé La vie est à nous paru en 2023.




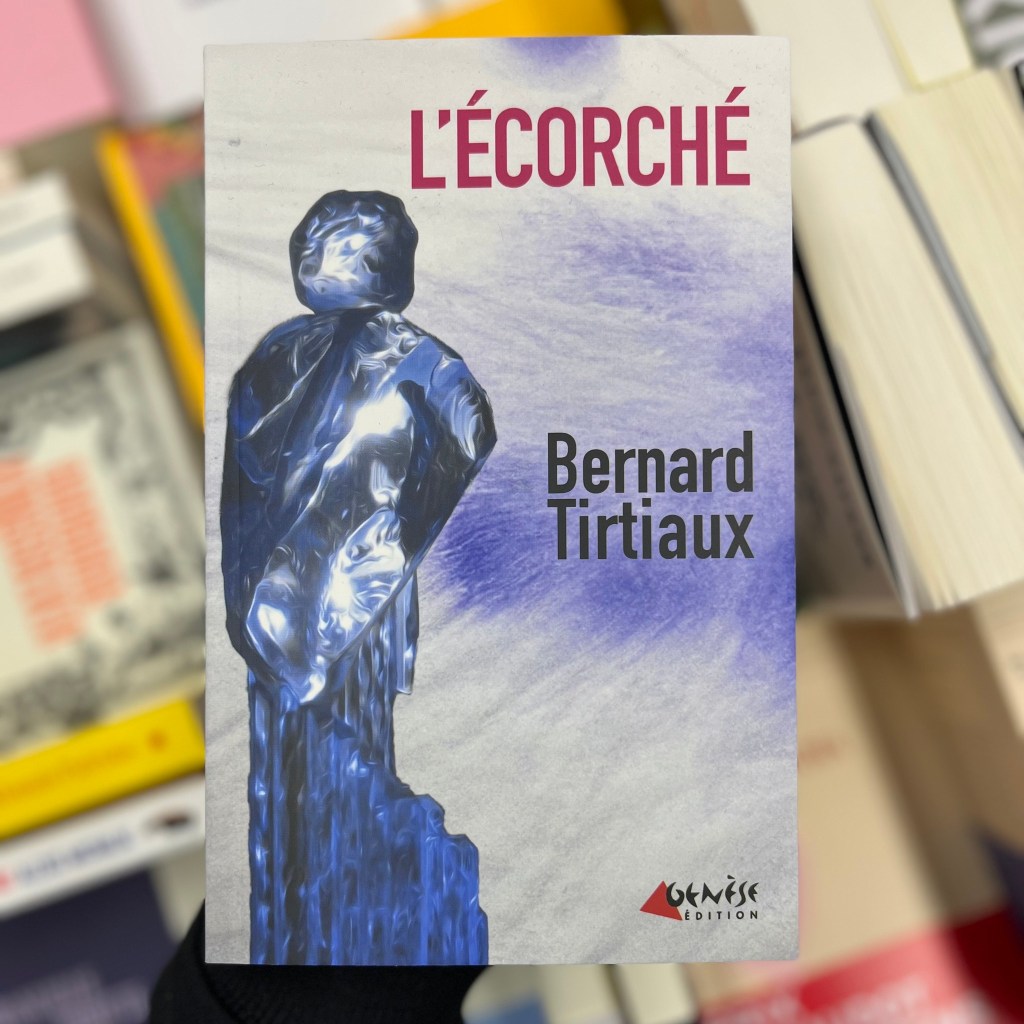
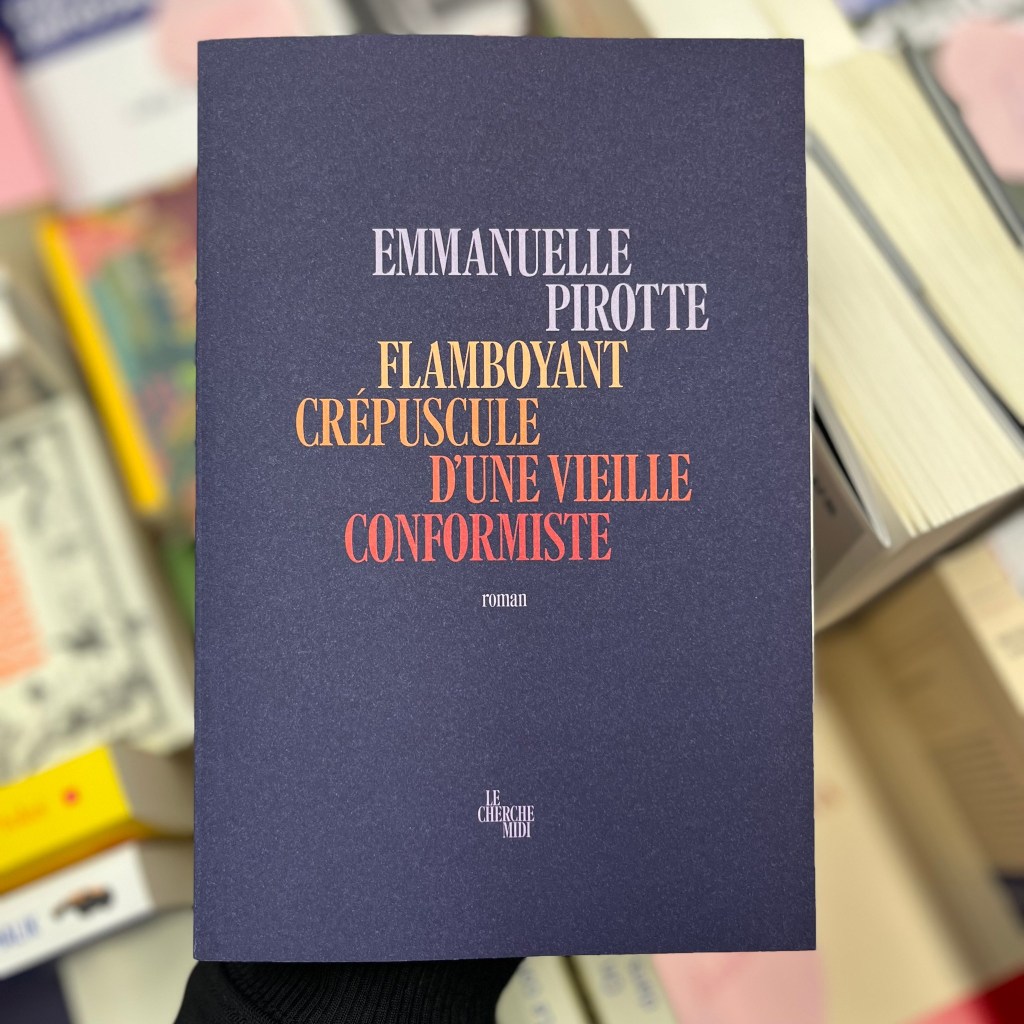







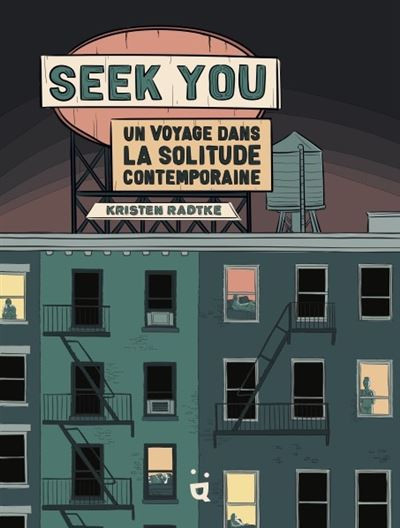


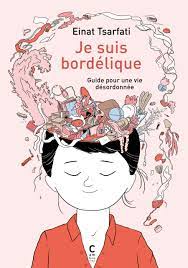



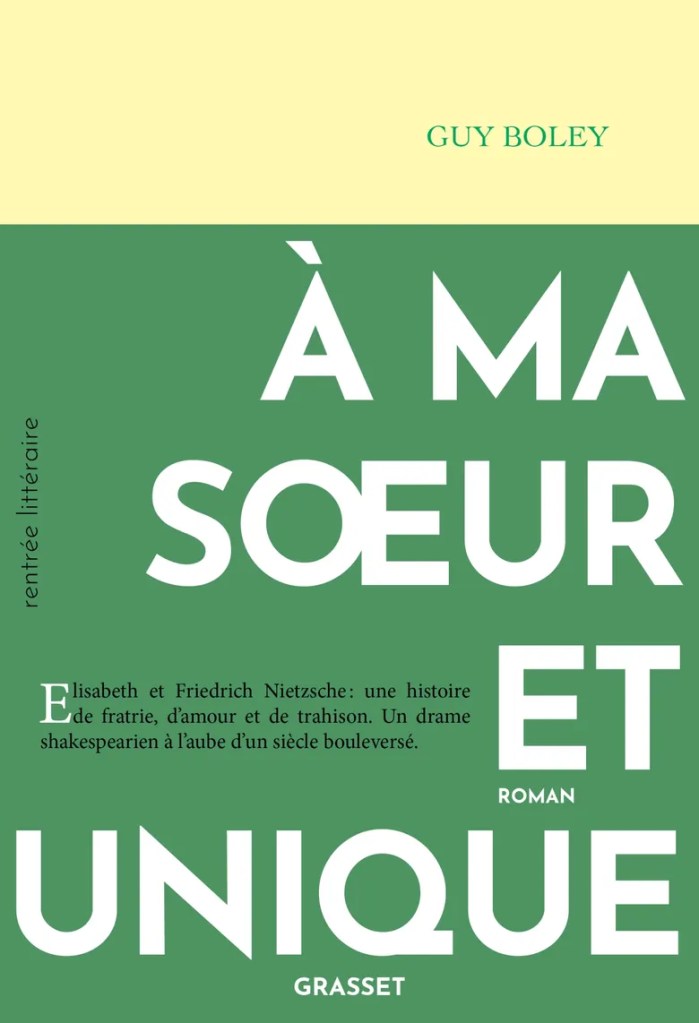
 , nous aurons des rencontres pour les adultes et pour les jeunes en partenariat avec la Bibliothèque de Gembloux rue des Oies ou avec le Centre Culturel l’Atrium dans le cadre du festival Sanza-ya-Congo initié par Ernage Animation.
, nous aurons des rencontres pour les adultes et pour les jeunes en partenariat avec la Bibliothèque de Gembloux rue des Oies ou avec le Centre Culturel l’Atrium dans le cadre du festival Sanza-ya-Congo initié par Ernage Animation.